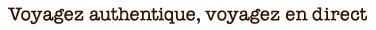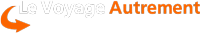Au milieu du 20e siècle, alors que les artistes européens se dirigent vers l'art conceptuel et le minimalisme, l'art féroïen garde le même cap et continue de s'inspirer des paysages de l'archipel. Ce qui pourrait être considéré comme une approche démodée et naïve de l'art visuel est en fait une belle preuve de l'absence de dérives doctrinaires qui pourraient pousser l'archipel à suivre le courant. Grâce à cette quasi absence d'ismes, l'expression artistique du territoire conserve son côté réaliste.
À cette époque, les conditions de vie aux Féroé sont encore difficiles et la nature, impitoyable, conserve tous ses droits. Les artistes locaux utilisent justement les souffrances liées à cette vie pour créer des œuvres uniques, à tel point que même le cubisme féroïen s'éloigne du cubisme classique de Braque et Picasso en intégrant des éléments réalistes.
Emblème de l'art cubique aux Féroé, le peintre Jack Kampmann s'installa sur l'archipel après la Seconde Guerre Mondiale. Ses œuvres, largement influencées par celles de Paul Cézanne, font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine artistique des îles Féroé. L'artiste influença notamment Ingálvur av Reyni, qui deviendra célèbre dans les années 1960 pour ses représentations abstraites des paysages du pays.
À la même époque, Zacharias Heinesen, fils de l'écrivain William Heinesen, commence à se faire connaître à travers des œuvres visionnaires. Ses maisons triangulaires et carrées, ses montagnes colorées et sa façon de capter la lumière inspirent et continuent d'inspirer les artistes des Féroé et d'ailleurs.
 ©
©