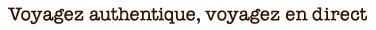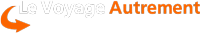Cette fois encore, il s'agit pour les envahisseurs d'assujettir les vaincus. Et cette fois encore, le religieux joue un rôle fondamental.
On détruit les temples de pierre pour construire des églises, on alphabétise et on catéchise ceux qu'on ne massacre pas ou qui ne meurent pas de la grippe et de la variole, et on rebaptise les lieux.
Le lac Titicaca, par sa puissance symbolique, est évidemment visé.
Sur sa berge sud, une petite bourgade a été fondée par les Incas pour accueillir les pèlerins qui accourent en nombre pour se rendre sur l'île du soleil, à quelques encablures de là.
Sur l'étymologie du lieu, les sources divergent, nous ne retiendrons que les deux hypothèses les plus répandues (qui sont aussi les plus crédibles).
Pour les uns, le village se nommerait Kota Kahuana, ce qui en aymara signifie "vue sur le lac".
Pour les autres, la bourgade s'appellerait Kotakawana, du nom de la déesse de la fécondité, équivalente à l'Aphrodite grecque ou à la Vénus romaine.
Cette divinité androgyne représentée avec un corps humain et une queue de poisson vivrait dans les eaux du lac Titicaca, accompagnée d'une cohorte de sirènes, les Umaantus.
Kota Kahuana, Kotakawana ... le nom est latinisé, la bourgade se nommera désormais Copacabana.
L'évangélisation des autochtones va bon train. Sous l'impulsion des Dominicains, en charge de la paroisse, le culte de la Vierge se popularise.
A la fin du XVIe siècle, la médiocrité des récoltes amène une partie de la population à solliciter l'intercession de la Vierge, et c'est un pêcheur, Francisco Tito Yupanki, qui sculpte une vierge noire aux traits indigènes qui prend place dans l'église locale.
Rapidement, on lui attribue une série de miracles, et sa réputation se répand à travers tout le continent.
Copacabana reste un lieu de pèlerinage, mais on y vient désormais pour vénérer cette vierge miraculeuse *.
 ©
©